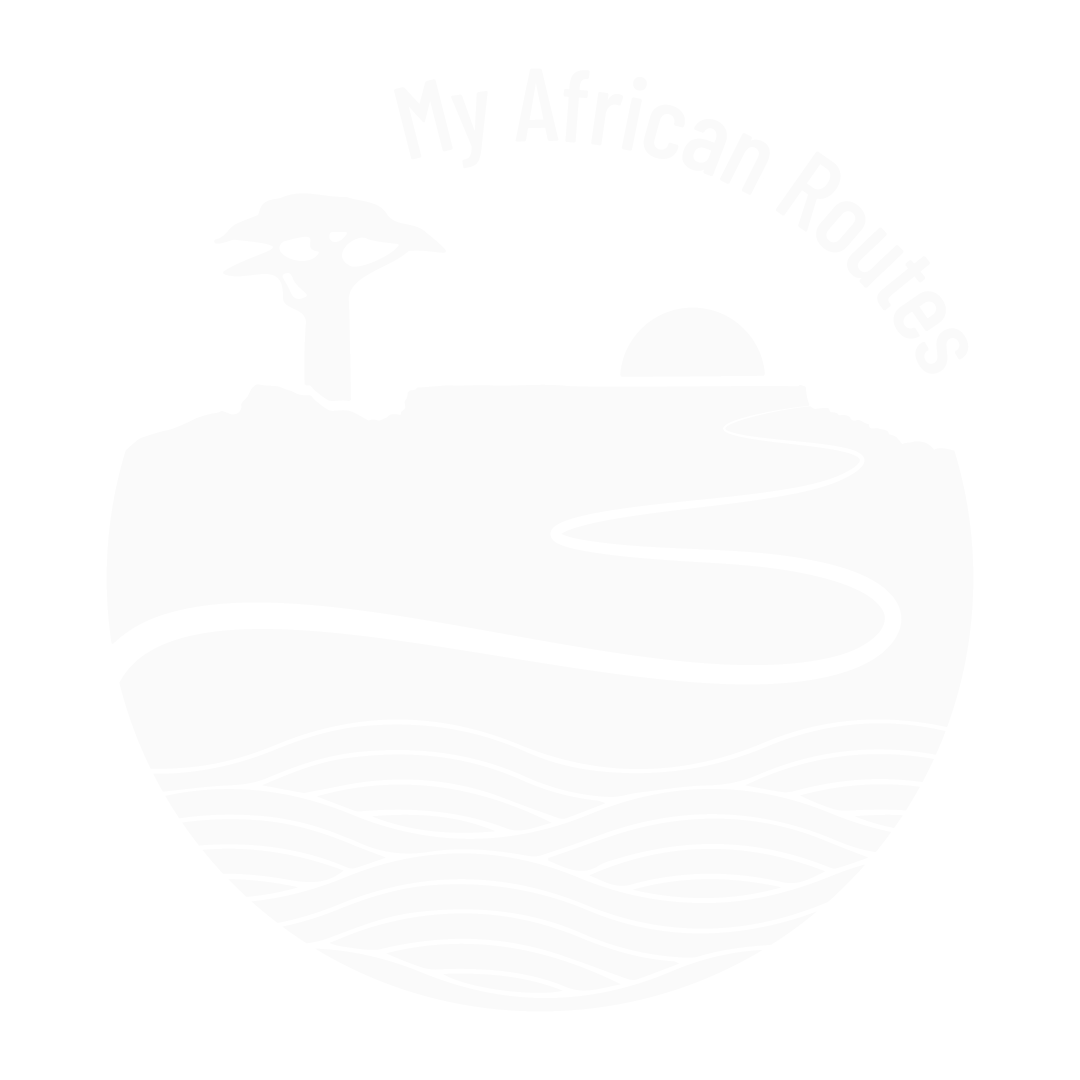Les protestants français — appelés Huguenots — fuyaient la persécution après la révocation de l’édit de Nantes en 1685 par le roi Louis XIV. Ils sont arrivés en Afrique du Sud à la fin du XVIIe siècle et ont transformé l’agriculture sud-africaine en apportant des boutures de vigne parfaitement adaptées au climat méditerranéen du Cap. Avec ses hivers pluvieux, ses étés chauds et secs, et les brises fraîches de l’océan, cette région s’est révélée idéale pour la culture de la vigne, produisant des vins mondialement reconnus pour leur complexité et leur équilibre.
Malgré leur influence culturelle et agricole, la langue française n’a pas perduré dans la colonie du Cap. Les Néerlandais, désireux de maintenir leur domination linguistique, ont découragé l’usage du français dès la première décennie suivant l’arrivée des Huguenots. Les enfants français étaient scolarisés en néerlandais et le français fut interdit dans les usages officiels et religieux. Avec le temps, les Huguenots se sont assimilés linguistiquement en adoptant le néerlandais, qui a ensuite évolué vers l’afrikaans.
De nombreux noms de famille issus de ces premiers colons — Malherbe, Joubert, Marais, du Toit, Graaff, Theron, de Villiers, Labuschagne et Le Roux — sont encore courants aujourd’hui en Afrique du Sud, témoignant de leur influence durable. Vous remarquerez ces noms en parcourant la région des vignobles du Cap. Vous serez étonné de découvrir que Roger Federer est issu d’une famille huguenote.
Aujourd’hui, l’héritage des Huguenots français perdure non seulement dans les vignobles et les vins sud-africains, mais aussi dans le tissu culturel du pays. Leur histoire de résilience et d’adaptation constitue un chapitre essentiel de l’histoire nationale et une invitation pour les voyageurs à découvrir les vignobles et les sites patrimoniaux qu’ils ont contribué à bâtir.